La différence des métiers "psy"
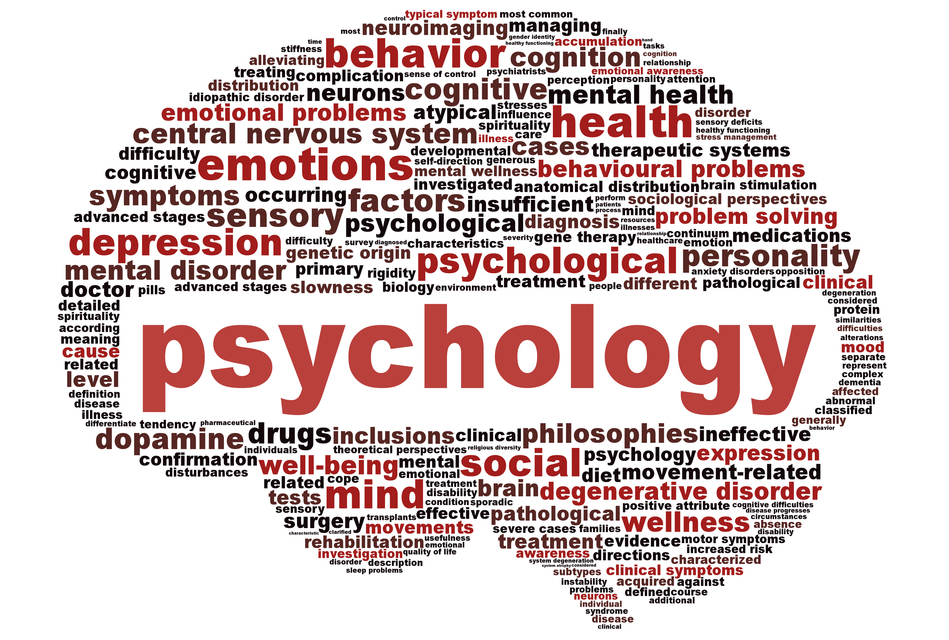
De cette "psyché", découlent les mots psychisme, psychologie, psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, psychotrope, psychopathologie, etc, voici quelques éclaircissements :
Psychiatre
Le ou la psychiatre est médecin (étude du corps, de sa chimie organique, de son fonctionnement et de ses dysfonctionnements. Un dossier sur la formation des psychiatres en 2000 est à ce jour consultable ici) qui a effectué une spécialisation après son internat. Il ou elle est habilité(e) à diagnostiquer les maladies mentales, à prescrire des médicaments et ses prestations sont partiellement remboursées par la sécurité sociale. Il peut pratiquer la psychothérapie mais n'a pas forcément, comme d’ailleurs tout le reste de la tribu «psy», de formation réellement adéquate pour la pratiquer.
Psychologue
La ou le psychologue est nécessairement détenteur d’un titre universitaire de 3ème cycle, un DESS (Diplôme d’Etudes Scientifiques Spécialisées) ou Master : 5 ans d’études après le bac et une sélection drastique à chaque année d’études ponctuées de stages spécialisés. Ce diplôme doit être enregistré au répertoire ADELI de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (la DASS), aux fins de protection contre l'usurpation de titres universitaires - cela dit, dans ce métier comme dans d'autres, un psychologue diplômé n'est pas automatiquement un bon thérapeute. Le psychologue s’est souvent spécialisé en « psychologie clinique et pathologique », mais l’on trouve aussi des enseignements qui, notamment à partir de la fin de 3ème année, forment les psychologues généticiens, les psychosociologues, les psychologues du travail.
Psychothérapeutes
Les psychothérapeutes. Jusqu'au décret du 20 mai 2010, absolument n'importe qui pouvait se dénommer psychothérapeute, sans aucune formation ni quelque expérience que ce soit. Ce vide législatif a ouvert la porte à nombre d'abus et dérives. Aujourd'hui, passée une période de transition afin que les "vrais" psychothérapeutes puissent faire valoir leurs formations et expérience devant une commission ad hoc qui leur octroiera le titre de psychothérapeute, ce titre sera protégé et ne pourra être porté qu'à conditions de formation théorique et stages, délivrés par des organismes de formation qui auront à se faire connaître. Cette loi, le décret et les arrêtés s'ensuivant me semblent certes très mal adaptés, privilégiant les médecins psychiatres et desservant les psychologues diplômés, mais devrait théoriquement juguler les dérives actuelles.
A ce jour - février 2011 - certains psychothérapeutes tentent de contourner la loi en voulant introduire le terme de "psypraticien" ou "psycho-praticien" afin de ne pas se conformer à une loi bientôt applicable. Ces appellations devraient rendre prudent le patient, de même que la seule appellation "psychothérapeute".
Psychanalyste
Le ou la psychanalyste postule, pour l'avoir constaté, l'existence de l'inconscient, partie du psychisme qui tient le principal rôle dans notre existence, dans ce qui "guide" nos pensées conscientes. Cette ou ce psychanalyste doit absolument avoir effectué jusqu'à "un certain terme" sa propre psychanalyse de façon approfondie, durant nombre d'années, avec un psychanalyste expérimenté. Il faut qu'il ait suivi un enseignement psychanalytique et il est bon que le commencement de sa pratique ait été supervisée par un confrère.
Dans les faits – hélas ? tant mieux ? - n’importe qui peut se prétendre psychanalyste - puisque la profession n’est pas réglementée. Mais si le psychanalyste usurpait ce titre, il y aurait fort à parier qu’il n’ait guère de clients, le bouche-à-oreille alors ne fonctionnant pas. Or pour subvenir à ses besoins dans ces professions, si l’on n’est pas médecin ou psychiatre, il faut beaucoup de patients.
Le psychanalyste est en quelque sorte «un accessoire» du film de son patient. Il fait partie du dispositif, du cadre analytique.
Ce saisissement du sens contribue à une lecture différente de la trame qui la constitue. Des changements s’ensuivent de cette mise au jour d’un sens plus propre que figuré, non tant par la volonté ou par une compréhension intellectuelle nouvelle, mais parce que la personne devient un peu plus actrice d’elle-même, un peu moins «agie» par son propre inconscient, c’est à dire par ce «soi-même-et-les-autres» aggloméré et a priori insécable.
Il faut au professionnel de quelque secteur comme pour être parent, éducateur, une «bonne distance» tant vis-à-vis de soi, praticien, que de l’autre et de sa demande ; un constant décryptage de la relation psychanalyste => analysant et analysant => psychanalyste.
